Avortements provoqués au Burkina Faso : risquer sa vie, de peur d'en donner

L’avortement provoqué n’est légal au Burkina Faso qu’à certaines conditions : sauver la vie de la mère, en cas de viol, d’inceste ou de malformation fœtale sévère. Et pourtant, il se pratique au quotidien. Clandestinement certes, mais dans des proportions inquiétantes. Voyage dans les entrailles du secret.
Elle n’a pas encore soufflé ses 16 bougies, mais elle est déjà passée par la « douleur de l’avortement provoqué», selon ses propres mots. Nous allons l’appeler A.S., un pseudonyme, pour répondre aux exigences du strict anonymat qu’elle a requis avant tout témoignage. A.S. est bien consciente que l’Interruption volontaire de grossesse (IVG) est interdite par la loi (sauf dans certains cas ; voir encadré1) et blâmée par la société burkinabè dans son ensemble. Lorsque nous la rencontrons une matinée de fin avril 2015, cette conscience du caractère répréhensible de l’IVG tranche d’avec la candeur de la jeune fille. D’une taille moyenne, vêtue d’une robe fleurie, les cheveux abandonnés à eux-mêmes, elle raconte sa mésaventure avec une insouciance perceptible tout de go. Cette jeune élève de la classe de 4e, dans un chef-lieu de la province de la Boucle du Mouhoun, ne s’est imaginée tomber enceinte maintenant. « Je ne pensais pas que cela pouvait m’arriver », nous lance-t-elle. Et pourtant, elle affirme avoir vu ses premières menstrues à l’âge de 14 ans et reconnait consommer l’intimité, sans préservatif, avec son jeune copain de 18 ans, lui aussi élève, en classe de seconde. Ce que A.S. n’imaginait pas, arriva. « Entretemps, je n’avais plus d’appétit, je me sentais fatiguée et je vomissais. Encouragée par une camarade, je suis allée faire le test de grossesse et c’était positif ; c’est comme si le ciel me tombait sur la tête », se souvient-elle. Seulement, A.S. n’est pas au bout de ses surprises, puisque le père, son camarde de 18 ans, tout en reconnaissant être l’auteur de la grossesse, propose d’avorter, à l’insu des parents. La tentative de camouflage fait long feu. La mère de A.S. est informée ainsi que le géniteur de l’auteur de la grossesse. « Mais après une première entrevue entre les deux parents, le père de mon ami n’a plus donné signe de vie », explique A.S. Les tractations se déroulent sans que le père de la fille ne s’en doute. « S’il avait su (ndlr : au moment des faits, puisqu’il le saura plus tard), il allait me tuer », croit-elle savoir. Une situation de désarroi qui conduit les membres de la famille de A.S. au recours ultime, l’avortement. Advienne que pourra, car les spécialistes de la santé sexuelle sont formels pour dire que tout avortement est risqué, encore plus lorsqu’il est clandestin. C’est une tante de A.S. qui est chargée de la mission. Sur place, dans la ville où étudie l’adolescente, l’opération pouvait s’ébruiter et peut-être que les « experts » de l’IVG n’y sont pas. C’est à Bobo-Dioulasso, deuxième ville du pays, que A.S. est conduite. « Nous sommes allées dans une clinique (pas d’autres précisions), on m’a remis de petits comprimés à avaler et à en mettre dans mon sexe. En plus, l’agent de santé m’a fait une injection, dit-il, pour atténuer la douleur ». Voici résumé ce qu’a subi A.S., pour 75 000 F CFA, selon ses confidences. Le lendemain de l’acte, poursuit-elle, les saignements ont commencé, avec à la clé des caillots de sang. Elle confie avoir eu très mal au ventre, en dépit de la piqûre anti-douleurs. Quelle description peut-elle faire de ce qu’elle a vécu. A cette question, A.S. manque de mots. Pour sûr, elle défend, « même sa pire ennemie », de s’aventurer dans l’IVG.
La peur de décevoir les parents
Et pourtant, M.K., une étudiante de 24 ans dans une école supérieure de Bobo-Dioulasso, est passée par là, au mois d’avril dernier. Habillée d’un pantalon communément appelé « taille basse » et d’un haut moulant, tous deux de couleur rose, elle est tressée de mèches. Un look sexy qui contraste d’avec son attitude durant notre entretien. C’est pratiquement la tête baissée, sur un ton bas et hésitant qu’elle nous livre quelques bribes de son histoire. Une histoire que M. K. garde jalousement, parce que ni ses parents, ni l’auteur de la grossesse, ne sont au courant de rien, nous signifie-t-elle. En effet, quand elle est tombée enceinte, elle dit avoir pris sur elle, toute seule, la décision d’avorter, pour ne pas décevoir les parents qui ont mis une confiance presqu’aveugle en elle. Pour son cas aussi, M.K. parle d’avoir pris de petits comprimés dont nous taisons volontairement les détails.
Au fait, elles sont nombreuses les jeunes filles ou femmes burkinabè qui ont recours à l’avortement provoqué pour empêcher une naissance non désirée. Une étude réalisée par des chercheurs de l’Institut supérieur des sciences de la population (ISSP), en collaboration avec leur partenaire Guttmacher Institute, a révélé que 105 000 avortements ont été pratiqués au Burkina Faso, en 2012. Ce n’est que la partie visible de l’iceberg, dans la mesure où de nombreux cas d’avortement, surtout provoqués, demeurent dans le secret absolu. Si certaines filles ou femmes sont prêtes à aller dans la tombe avec leur secret d’IVG, d’autres ne sont pas jusqu’au-boutistes. Face aux conséquences, souvent fâcheuses des IVG clandestines, sur le double plan sanitaire (hémorragie, infections locales ou généralisées, infertilité, décès) et psychologique, cette dernière catégorie de femmes sollicitent des Soins après-avortement (SAA). Les SAA complets proposent un traitement médical d’urgence aux femmes victimes de complications liées à l’avortement, ainsi que des services de planning familial et d’autres services appropriés de santé de la reproduction. Au « pays des hommes intègres », ces soins sont offerts, en fonction de la gravité des complications, à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Du Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) au Centre hospitalier national/universitaire. Mariam Nonguierma/Zoromé, est sage-femme à la maternité de l’hôpital Yalgado Ouédraogo. Elle est, par ailleurs, la présidente de l’Association burkinabè des sages-femmes. Mme Nonguierma reconnaît l’existence de l’offre des soins après avortement au plus grand hôpital du pays. Quand nous avons voulu avoir des statistiques sur les IVG, elle s’empresse de nous préciser qu’au centre de santé, l’avortement n’a pas de couleur. « Ce n’est pas la gendarmerie, l’objectif est d’apporter des soins et non de chercher à savoir s’il s’agit d’un avortement provoqué ou spontané », ironise-t-elle. Néanmoins, en parcourant l’annuaire statistique 2014 du CHU-YO, au titre du Service de gynéco-obstétrique, nous avons relevé 372 avortements pour 9 décès. Des décès des suites d’IVG, la sage-femme affirme en avoir été témoin. « Une femme mariée est venue une fois avec des saignements abondants ; nous n’avons pas pu la sauver », rapporte Mme Mariam Nonguierma/Zoromé. Elle nous fait savoir que la dame en question avait 4 enfants et que le dernier avait 8 mois.
D’autres ont eu plus de chance. A.S. et M.K. citées plus haut, ont, toutes deux, bénéficié de SAA. « On dirait qu’il restait des déchets dans l’utérus, après l’avortement. Je suis repartie dans la clinique où cela a eu lieu et l’agent m’a orientée vers l’ABBEF (ndlr : une clinique de l’Association burkinabè pour le bien-être familial dans la capitale économique) ; j’ai fait une échographie, et après on m’a fait un curetage. J’ai eu très mal », développe A.S. Mme Abibata Paré, sage-femme officiant dans cette clinique ABBEF/Bobo, confie recevoir entre 60 et 70 cas d’avortement par mois, dont 20 à 30 IVG. « Mais il arrive que nous référions à l’échelon supérieur de la pyramide sanitaire. Celles qui arrivent avec l’utérus perforé ou une infection généralisée sont référées», indique Mme Paré.
Combattre le mal à la racine
Par essence, l’avortement provoqué est l’aboutissement de grossesse non désirée et non planifiée. L’étude de l’ISSP et de Guttmacher Institute établit que trois grossesses sur 10 ne sont pas désirées et une grossesse non intentionnelle sur trois se termine par un avortement. C’est dire que la
cause première de la fréquence des IVG est à rechercher dans le niveau d’utilisation de la contraception; le taux de prévalence contraceptive étant estimé à 15-16% au Burkina Faso. Si bien que, dans la pratique, de nombreuses femmes qui ne veulent pas tomber enceinte, n’utilisent pas, paradoxalement, les moyens qui leur sont offerts pour éviter les grossesses non intentionnelles. C’est pourquoi, nous informent les sages-femmes rencontrées, les soins après avortement sont toujours accompagnés de counseling dans le but de soumettre la patiente à la contraception. L’adoption de la contraception étant volontaire, ça ne marche pas à tous les coups, relativise Mme Abibata Paré de l’ABBEF/Bobo-Dioulasso. Elle nous relate l’histoire d’une jeune élève qui, en l’espace de deux mois (fin décembre 2014 et fin février 2015) a été reçue deux fois pour des Soins après avortement. Et ce n’est pas un cas isolé, déplore la sage-femme. Elle ne désespère pas pour autant, convaincue qu’avec une intensification des efforts, la planification familliale pourrait s’arroger une meilleure réputation. En effet, de nombreux préjugés continuent de hanter la contraception. M.K., l’étudiante de Bobo-Dioulasso, justifie sa méfiance vis-à-vis des produits contraceptifs par « leur dangerosité supposée pour la fécondité ». Elle déclare avoir accompagné, parfois, une de ses amies pour renouveler la contraception de cette dernière, mais n’avoir jamais eu « le courage » de confronter les « on-dit » de sa mère, à l’avis des spécialistes. Vous auriez pu utiliser les préservatifs, qui font également partie des contraceptifs et en plus protègent contre les IST et le VIH/Sida, relançons-nous. M.K. rétorque « on ne peut pas porter ça tout le temps ». L’insouciance et les résistances ont la peau dure, souligne Mme Nonguierma du CHU-YO. Tout comme sa collègue de l’ABBEF, elle se montre, tout de même, optimiste. A son sens, il faudrait une approche à plusieurs niveaux, c’est-à-dire, assurer l’éducation sexuelle en famille, à l’école et en dehors, dans les centres de santé, chez les OSC, etc., pour réussir le pari d’une sexualité plus responsable chez les jeunes célibataires, mais aussi dans les couples. Cette sage-femme encourage l’extension de la méthode dite avancée dans le repositionnement de la PF. Il s’agit pour les acteurs d’aller vers les populations pour leur donner la bonne information sur la contraception et leur offrir les produits appropriés, en tenant compte des spécificités de chaque groupe. Le chemin est peut être long, mais c’est une voie royale, si l’on veut faire baisser le niveau actuel des avortements à risque dans le pays, soutient-elle.
Source : sidwaya.bf
Articles similaires
A Voir aussi
Recette
Agenda
Newsletter
Abonnez vous à la newsletter pour recevoir nos articles en exclusivité. C'est gratuit!

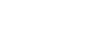




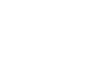

Commentaires