Marguerite Abouet : ``mon travail, c`est de raconter une autre Afrique``

Raconter l'Afrique, voilà la mission que s'est donnée Marguerite Abouet. L'aventure a commencé il y a un peu plus de dix ans, avec la parution du premier volume de la très célèbre Aya de Yopougon. Cinq tomes et 700 000 exemplaires plus tard, le quotidien de cette adolescente ivoirienne dans le quartier de Yopongon, à Abidjan, n'a plus de secrets pour ses lecteurs, issus des quatre coins du monde. Adaptés au cinéma en 2013, les personnages de l'œuvre de Marguerite Abouet et de Clément Oubrerie prennent vie. Un plaisir que la scénariste ivoirienne n'a pas boudé. Pourtant, quand le réalisateur sénégalais Moussa Sène Absa lui propose d'écrire le scénario de la série C'est la vie, destinée à plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, elle refuse. La peur d'un ton qui se voudrait trop moralisateur. Le cinéaste lui explique alors son souhait d'aborder, avec elle, des sujets réputés sensibles.
Touchée par la démarche et avide de proposer un contenu de qualité aux téléspectateurs africains, elle accepte. Et voilà le centre de santé du quartier imaginaire de Ratanga qui prend vie, autour de quatre femmes puissantes qui devront faire face à différents rebondissements : un cas présumé à tort d'Ebola, une campagne de vaccination, un trafic de faux médicaments ou encore les difficultés d'accès aux soins en zone rurale.
Il faut dire que, forte du succès de la saison 1, l'équipe a pu bénéficier d'un budget important assez rare sur le continent (environ 30 000 euros par épisode) pour être souligné. Conséquence aussi, le recrutement d'une équipe de réalisateurs élargie autour des deux scénaristes, Marguerite Abouet et Charli Beléteau (Plus belle la vie saison 1), on retrouve Lionel Meta venu du Cameroun, Lucrèce D'Almeida du Bénin, Idrissa Guiro et Fatou Kande Senghor du Sénégal, Salimata Tapily du Mali, Magagi Issoufou et Tom Ouédraogo venus du Burkina Faso et d'autres qui ont été sollicités, parfois au dernier moment.
Marguerite Abouet va alors, au sein d'une équipe, faire ce qu'elle aime : raconter des histoires. Les mots de la scénariste vont rythmer la vie des personnages du centre de santé de Ratanga, une ville africaine imaginée pour l'occasion. Mariage, accès aux médicaments, sexualité… Autant de sujets abordés dans la série, exploités dans le but de faire changer les comportements. La chaîne cryptée A+ diffuse aujourd'hui la saison 2, qui compte 36 épisodes. Marguerite Abouet a accepté de nous en dire plus sur cette nouvelle aventure.
Quelles étaient vos ambitions au moment de l'écriture de la saison 2 de C'est la vie ?
Dans la saison 2, on retrouve nos quatre héroïnes (Assitan, Korsa, Magar, Emade) et tous les autres personnages qui gravitent autour d'elles. Ce qui était important pour nous, pour cette saison 2, c'était de raconter la jeunesse. Parce que la jeunesse africaine représente la moitié de ce continent. Et, quand on parle de jeunesse, on parle d'éducation, de sexualité, de rapports difficiles avec les parents, etc. Mais il nous paraissait important d'aborder avant tout les difficultés de ces jeunes, pas seulement d'effleurer le thème de la jeunesse. Car, après tout, la jeunesse africaine ressemble à n'importe quelle jeunesse du monde en réalité. Mais nous, notre difficulté était de parler de leurs rapports à la sexualité et de dire que oui, les jeunes ont des rapports sexuels. Il faut qu'on en parle, il ne faut pas que ça soit tabou, pour justement qu'ils aient des armes : avoir des endroits, des plannings familiaux, où ils peuvent avoir des informations, des adultes qui les guident et ne les jugent pas.
Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de participer à un projet dont le contenu est fortement orienté avec des objectifs de communication sur les enjeux de santé ?
Au début, lorsque le producteur m'a appelée et m'a parlé de ce projet avec des messages, je lui ai dit non. Car, justement, mon travail à moi, c'est de raconter une autre Afrique, pas d'être didactique et pédagogique. À chaque fois que l'on s'adresse aux Africains, on a l'impression que l'on doit leur apprendre à se soigner et à arrêter de faire la guerre. Moi, je ne suis pas dans cette démarche. Et puis il m'a dit : « Est-ce que je peux te rencontrer à Paris ? Il faut vraiment que ça soit toi, tu es la mieux placée. » Alors j'ai accepté de le rencontrer.
Il m'a parlé de chiffres : une fille sur deux accouche avant l'âge de 18 ans en Afrique, une petite fille sur deux est excisée, de nombreuses femmes ne savent même pas ce que c'est que les quatre visites prénatales. Cela signifie qu'elles ne vont même pas voir un médecin, une sage-femme… Une femme sur 162 meurt en donnant la vie, alors que, dans les pays développés, c'est une femme sur 43 000. C'est énorme. Donc, en fait, les chiffres m'ont quand même convaincue. Je me suis dit : « Moi, ce que j'aime, c'est raconter des histoires liées aux problèmes des femmes et justement pourquoi ne pas faire cette série ? » Mais, en même temps, ce qui m'importait, c'était d'y intégrer les 70 % de divertissement. On a 30 % de messages. Donc à moi de créer des personnages. C'est un vrai challenge, un vrai défi pour moi qui veux travailler en Afrique, qui veux faire des projets avec les jeunes, avec les femmes. C'était une belle occasion.
Est-ce que cela ne vous a pas frustrée, vous qui êtes dans un univers imaginatif et créatif ? Comment avez-vous procédé pour écrire sur des sujets très concrets, très terre à terre...
Non, cela ne m'a pas frustrée comme on peut le penser. Parce que je m'identifie beaucoup à mes personnages. Je crie des personnages qui me ressemblent. C'est peut-être pour ça qu'elles sont si féministes, parce que, malgré leur vulnérabilité, les femmes africaines sont les chances de ce continent. Quand vous prenez ce personnage, Assitan, qui veut révolutionner le centre de santé, qui ne veut pas vivre avec un homme et qui n'est pas mariée, alors qu'en Afrique on a comme un diktat, c'est comme si on avait besoin de se marier.
Quand on voit la jeune Émadé, tombée en enceinte jeune et qui aujourd'hui décide de se prendre en charge, de faire des choix, de ne plus être juste « la femme de », reprendre ses études, travailler dans une bibliothèque de jeunesse, et surtout de partir de chez sa belle-mère, moi, je me retrouve dans ces personnages-là. Donc je ne suis pas frustrée puisque mes personnages sont des personnages transitoires. C'est comme dans la vie. On a des personnages positifs et négatifs. Les positifs sont ceux qui te permettent d'avancer, et les négatifs te diront toujours que tu es une bonne à rien. C'est tout cela que je raconte.
Avec Aya, avec Bienvenue, avec mon autre projet de long-métrage que j'écris et qui va se passer entre l'Afrique et la France. La où je suis un peu frustrée, c'est dans le fait de ne pas pouvoir tout dire. Car il y a des choses quand même tabou. Même si on arrive à se faufiler et à raconter quelques histoires, il faut dire qu'il y a un fossé entre ce que l'on écrit et ce qui est tourné.
Vous parlez du refus de certains acteurs à tourner certaines scènes... Est-ce que ça n'est pas trop frustrant ?
Oui, c'est beaucoup de discussions sur des sujets difficiles et la façon de tourner ces scènes, mais c'est ça aussi ce projet C'est la vie, c'est de susciter des débats. Et, à partir du moment où il y a débat, on parle beaucoup et on écoute beaucoup. L'excision est un sujet difficile, car on n'en meurt pas. Si la petite fille meurt, on va dire : « C'est parce qu'il y avait de mauvais génies qui passaient. » On ne dira pas : « Elle est morte car elle a fait une hémorragie, parce que la lame était rouillée. » Et c'est là où j'interviens à ma manière. Dans l'un des épisodes, je fais mourir la deuxième fille de Maga, la plus jolie, celle qui s'occupe le plus de sa mère, pour que justement il y ait un déclic.
Et il fallait aussi discuter avec tout le monde à côté parce que personne ne voulait qu'elle meure. « Marguerite, tu n'es pas musulmane, tu n'es pas de chez nous. Tu ne comprends pas. » Moi, je réponds que je suis africaine, j'ai vécu et je connais l'Afrique, j'y vais. Il y a des petites filles qui meurent de l'excision. Et donc soit je raconte comme ça, soit je ne raconte pas. Pareil avec les femmes battues.
Ce n'est pas évident de pointer du doigt un homme. Une femme sur deux en Afrique pense qu'un mari peut battre sa femme s'il a des raisons valables. Et donc nous on dit que ce n'est pas normal. Elle peut porter plainte. Elle peut aussi emmener l'exciseuse devant la juge. Et c'est ce qui va se passer dans la saison 2. Nous, on a voulu aller jusqu'au bout. Elle est jugée, elle est punie. Ce sont des sujets difficiles. Comme le VIH, traité dans un épisode. C'était difficile.
Quelles ont été les réactions des spectateurs ? Les redoutez-vous toujours ?
Non, je ne redoute pas les réactions. La saison 1 a suscité beaucoup de débats, mais on a dit les choses. Quand je vais en Afrique et que je dis que c'est moi derrière C'est la vie, les filles me disent : « Il faut que tu parles de ça ! . Elles se disent : « C'est super, pour une fois que l'on raconte des choses qui nous ressemblent. » C'est la vie, c'est s'approprier nos écrans. C'est pour cela que je fais exprès de mettre des femmes et filles africaines qui ne font pas cliché. On y croit et on y est.
Quel regard portez-vous sur l'évolution du cinéma en Afrique ?
Le cinéma est en voie de disparition en Afrique. Les téléphones et les écrans le remplacent. Quand j'étais petite, on avait des cinémas dans chaque quartier. Aujourd'hui, ce sont des îlots esseulés un peu partout. Il faudrait revenir au cinéma. Les jeunes Africains ne savent même pas ce qu'est le cinéma, ils connaissent juste les séries. Mon rêve, c'est de faire des films, de les projeter en Afrique. Avec Aya, j'avais tellement envie de le montrer en Afrique qu'on a fait des projections en plein air, dans des terrains de foot, des villages. Les gens sont en attente.
Pourtant, il y a un dynamisme dans la création audiovisuelle…
Oui, mais dans les séries. Quand Alain Gomis fait Félicité, c'est vu en Europe. Il a des prix en Europe. Il y a encore la Fespaco, où on peut se réconcilier avec cet art. Tous ces films n'intéressent pas vraiment les Africains. Les trois quarts des séries africaines sont irregardables.
Bien souvent, le contenu n'est pas à la hauteur. Les créateurs ont les yeux braqués sur les ménagères. Mais les jeunes ? Les classes moyennes ? Elles regardent les séries américaines, pas Nollywood. C'est ce que je reproche un peu à tous ces grands groupes qui viennent en Afrique. Le discours de dire qu'on vient apporter de l'aide est bien beau, mais en fait ils sont encore dans une politique d'affichage et ne mettent pas assez d'argent dans les projets. Car ils disent que les Africains sont capables de regarder des séries médiocres. C'est dommage.
Source: afrique.lepoint.fr
Articles similaires
A Voir aussi
Recette
Agenda
Newsletter
Abonnez vous à la newsletter pour recevoir nos articles en exclusivité. C'est gratuit!

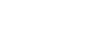




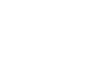

Commentaires