Salima Tlemçani : son parcours de femme journaliste en Algérie

Grand reporter pour le quotidien El Watan depuis 24 ans, Salima Tlemçani est une icône de la société algérienne. Très active pendant la sanglante décennie noire, où son nom s’est retrouvé sur une liste de personnes condamnées à mort, elle raconte son combat de femme journaliste en Algérie. Elle dresse aussi un constat amer sur la liberté de la presse et sur l’avenir de sa profession. Une voix libre et courageuse.
Elle avait, la première, en juillet 2001, révélé le sort des Algériennes qui cherchaient leur avenir à Hassi Messaoud, l'eldorado pétrolier en plein désert. Salima Tlemçani a raconté dans les colonnes de son journal, le quotidien francophone El Watan la sombre réalité de ces pionnières parties tenter leur chance pour une vie meilleure. Une enquête qui fait froid dans le dos. "Ces femmes étaient suivies, attaquées chez elles, battues, parfois torturées, souvent violées, systématiquement dépouillées de leurs biens et enfin menacées de mort si jamais elles parlaient. Leurs agresseurs : des hommes, semble-t-il du coin, agissant en bandes, armés de grands couteaux, de gourdins et de haches. Les victimes : des femmes seules, originaires du nord de l’Algérie, venues chercher du travail dans cette ville théoriquement ultrasécurisée".
Un reportage, parmi d'autres, pour lequel la journaliste fut récompensée de prix multiples. Un petit réconfort pour cette plume toujours menacée en son pays, qui signe ses chroniques d'un pseudonyme et qui préfère ne pas apparaître. Rencontre
Se retrouver sur une liste de journalistes condamnés à mort, c’était très dur à supporter et à vivre
Comment êtes-vous devenue journaliste ?
Salima Tlemçani : Je n’ai pas fait d’école de journalisme mais des études de biologie marine. Ma spécialité était l’aquaculture. C’était à l’époque du parti unique où seuls les journaux privés existaient. J’ai profité des événements de 1988 et la création de journaux en 1990. J’ai alors proposé des articles sur l’environnement. Mon premier reportage a été publié dans un hebdomadaire qui s’appelait « l’Eveil » et qui n’existe plus aujourd’hui. Il appartenait à un parti islamiste qui a disparu maintenant. Je voyais l’ambiance. C’était au début des années 90. J’étais la seule femme au milieu de ces hommes, je ne portais pas le voile en plus. J’ai ensuite intégré un autre journal, « le quotidien d’Algérie ». J’y ai travaillé de 91 à 92 puis j’ai rejoint l’équipe d’El Watan.
Avec les années noires, votre travail à El Watan a rapidement évolué…
J’ai travaillé sur des questions environnementales au début. J’ai mené des enquêtes économiques, mais jamais je n’aurais pensé qu’un jour je pourrais me transformer en « croque-mort », devenir quelqu’un qui compte les cadavres. C’était la situation sécuritaire qui l’imposait. Je voyais mal comment continuer à écrire sur l’environnement alors que dans chaque coin de rue, il y avait des dizaines de morts, des collègues qui se faisaient assassiner. Je me retrouvais plongée dans des conditions extrêmement difficiles car c’était une période où on ne faisait plus son métier. On faisait en sorte de faire tourner un journal. C’était un combat de chaque jour pour que le journal soit dans les mains des lecteurs. C’était une question de vie ou de mort. Les terroristes s’attaquaient aussi aux femmes, et particulièrement à celles qui ne portaient pas le foulard.
Comment gériez-vous cette peur ?
Se retrouver sur une liste de journalistes condamnés à mort, c’était très dur à supporter et à vivre. Vous finissez par côtoyer la mort au quotidien et vous finissez par admettre que vous allez mourir, votre seul souhait est que ça soit une mort immédiate. Pas une mort de souffrance, égorgée avec un couteau non aiguisé, ou torturée, ou violée ou je ne sais quoi. Pendant 10 ans, oui j’ai eu peur. Peur de perdre un membre de ma famille, tué à cause de moi. J’ai vécu avec la peur de me retrouver entre les mains d’un groupe aussi sanguinaire que sauvage. J’ai vécu avec la peur d’arriver au bureau et d’apprendre la mort d’un collègue, assassiné. Quand le geste le plus banal, d’aller acheter des croissants à côté, juste là, en bas de la maison, devient dangereux, c’est fini. Vous entrez dans une spirale infernale et votre seul compagnon c’est la peur.
Qu’est-il advenu de cette peur?
C’est fini. Elle n’existe plus.
Quelle est la situation de la presse algérienne aujourd’hui ?
La presse vit une situation complètement différente de celles des années 1990. On est entré dans une situation que la presse occidentale a vécue aussi et qui est toujours d’actualité. C’est le poids des lobbys financiers de plus en plus important dans les rédactions. Je me demande parfois si ce n’est pas la fin de la presse. D’un côté on vous étouffe financièrement, d’un autre il y a des magnas de la finance qui sont prêts à racheter toute la presse.
Le combat a changé de visage et de forme ?
Les mentalités rétrogrades et l’idéologie islamiste avancent d’une manière incroyable au sein de la société. C’est moins flagrant et plus insidieux. C’est très pernicieux au sein de l’école. Le combat au début, c’était pour la vie contre la mort. Maintenant, c’est plutôt pour des principes, des idéaux et valeurs que l’on est obligés de se battre au quotidien.
On a affaire, non pas à des groupes extrémistes qui sont des ennemis identifiés, mais à la société en grande partie. Des intellectuels parfois, des journalistes, des hommes politiques qui, lorsqu’il s’agit des droits des femmes, vous disent que cela n’est pas prioritaire et on passe à autre chose.
Le code de la famille conditionne-t-il trop la société algérienne ?
Le code de la famille c’est la source de toutes les violences à l’égard des femmes.
Instauré en 1884 et inspiré de la Charia, le "Code de la Famille" algérien dénie l’égalité homme-femme, notamment en matière de mariage, divorce et tutelle des enfants. Fortement défendu par les islamistes conservateurs.
Mais il est considéré comme normal puisque nous sommes un pays musulman. Le problème c’est la Charia, qui n’est appliquée que lorsqu’il s’agit de la femme et de l’enfant. On ne l’applique pas quand il s’agit d’importation d’alcool, de prostitution, de corruption. Les lois sont universelles, alors pourquoi le Coran ne s’applique qu’aux femmes et aux enfants ? Parce que la femme et la famille constituent le socle de la société et changer cela c’est changer la société. Il y a un donc un refus de changer et donc un refus de lâcher l’emprise sur la femme et la famille. C’est ça qui se passe aujourd’hui. C’est un combat.
Les sujets sur les femmes sont souvent relégués au second plan
Ce combat existe-t-il dans les rédactions ?
Oui. Les sujets sur les femmes et sur la société sont souvent relégués au second plan. Pour les mettre en avant, c’est difficile. On est toujours à transformer la date du 8 mars, à lui donner un cachet folklorique, à offrir des roses ou embrasser les femmes. Mais vous savez au fond, ceux là mêmes qui sont les premiers à offrir des roses violentent leurs épouses et ne laissent pas leurs filles aller à l’école. Voici les paradoxes que l’on vit quotidiennement et qui nous mettent en situation de militante engagée. C’est un combat éternel qui n’en finit pas.
Aujourd’hui en Algérie, 65% des diplômés sont des femmes, mais seulement 17% d’entre elles travaillent (Source Le Monde- 2014). Pourquoi ?
Vous savez, on vit une situation paradoxale : des filles réussissent très bien, elles sont au premier rang et obtiennent les meilleures notes. Sur les 100 meilleurs bacheliers, plus de 70 sont des filles. Malheureusement, quand elles dépassent l’étape de l’université, la donne change car il y a le problème du mariage. Si on monte dans l’échelle sociale, elles sont aussi de moins en moins nombreuses. Il y a un problème de chances d’accès aux postes à responsabilité et c’est très révélateur. Il y a une réticence sociale, même au sein des partis les plus démocrates. Par exemple, le parti le plus ancien, le FLN, n’a qu’une seule femme au niveau du bureau politique. Ça vous donne une idée de la réticence, de l’opposition à l’accès des femmes aux postes décisionnaires.
D’où vient cette réticence ?
Moi je dis toujours que cela renvoie au regard réducteur que l’homme porte à la femme. Je suppose que ce n’est pas particulier à un pays comme le notre, on le voit aussi ailleurs. Mais cela devient plus prononcé car nous vivons des situations très particulières, notamment liées à la progression de l’intégrisme et d’idéologies traditionnelles qui viennent s’imbriquer et qui font qu’aujourd’hui celles qui occupent des postes à haute responsabilité sont moins nombreuses.
Il faut être capable de sacrifier sa vie privée, sa famille, son temps, ses amis, car on vous voit toujours comme quelqu’un qui va répéter ce que vous allez dire. C’est ça le journalisme
Cela fait 26 ans que vous êtes sur le terrain. Quel regard portez-vous sur la nouvelle génération de femmes journalistes ?
Oh, c’est difficile. En fait la nouvelle génération n’est pas encadrée. C’est une génération qui a été scolarisée pendant la période de terrorisme. Les forces militantes et associatives avaient déserté l’école et l’université. L’idéologie rétrograde y a donc progressé. Vous allez trouver peut-être dans le lot, mais de façon très minime, des journalistes qui viennent vers le métier parce qu’ils l’aiment, parce qu’ils veulent défendre des valeurs et des principes. La plupart d’entre eux viennent vers ce métier parce qu’ils veulent un salaire. La preuve, c’est que sur le terrain, vous trouvez peu de jeunes qui enquêtent.
Diriez-vous que le journalisme algérien perd son âme ?
Disons oui. Pratiquement. (Silence). C’est très dur de le dire, mais c’est une réalité. Les facteurs sont nombreux. Vous avez le poids des islamo-conservateurs comme je les appelle, le poids des lobbys financiers car cela les intéresse d’avoir une presse médiocre, qui n’est qu’un relais à la solde du gouvernement, la voix du maître. Et il y a aussi un gouvernement qui veut une presse docile malléable et corvéable. C’est un tout. Il y a aussi les directeurs des organes de presse qui ont une part de responsabilité. Il y a eu une période très faste où ils se sont fait beaucoup d’argent. Et aujourd’hui cela ne les intéresse pas d’aller vers la qualité du produit. Ils se contentent du peu qu’il y a, pourvu qu’il y ait de la publicité, pourvu que la manne continue à renflouer les caisses.
Que diriez-vous à une jeune femme qui souhaite devenir journaliste en Algérie ?
C’est un dur métier, surtout pour une femme. Vous savez, le taux de célibat est beaucoup plus important pour les femmes qui évoluent, travaillent et réussissent. Celles là, soit se marient très tard, soit ne se marient pas. Parce qu’elles font peur. Elles ne sont pas dociles, elles posent trop de question, elles sont tout le temps absentes... C’est une réalité amère. Pour venir vers ce métier il faut être bien armée, avoir des idéaux forts pour lesquels on est prête à se sacrifier. Il faut être capable de sacrifier sa vie privée, sa famille, son temps, ses amis, car on vous voit toujours comme quelqu’un qui va répéter ce que vous allez dire. C’est ça le journalisme.
Nous nous sommes forgés dans le sang
N’avez-vous jamais regretté d’exercer ce métier ?
Je regrette beaucoup de choses. (Silence). Je regrette d’avoir perdu 10 ans de ma vie par exemple. (Silence). C’est un peu particulier parce que nous avons traversé la période la plus difficile. La presse privée a commencé avec le terrorisme. Nous le printemps arabe, on a connu ça en 1990. Pour nous, c’était une nouvelle étape, avec un son de cloche différent, avec un succès terrible sur le terrain. C’est à ce tournant, là où on devait aller vers le professionnalisme… Le terrorisme a freiné beaucoup d’élans. Certains ont dû quitter le pays. D’autres ont été assassinés. Ceux qui sont restés ici… Nous nous sommes forgés dans le sang.
Comment voyez-vous l’avenir du journalisme en Algérie ?
Aujourd’hui, à défaut d’un syndicat fort qui défende les journalistes, à défaut d’un conseil d’éthique qui soit un garde-fou quand il y a diffamation ou insulte, à quoi vous attendez-vous ? Attendez vous à des dérives extrêmement importantes. Les responsables des médias ne font rien pour changer les choses. Ils se renvoient la balle, sous prétexte que celui là est proche du gouvernement, celui là dépend de l’opposition, celui-ci des hommes d’affaires. Nous sommes à un virage extrêmement dangereux. Je m’inquiète vraiment pour l’avenir de la corporation. Que sera-t-elle demain ? Je peux dire que ce sera très noir, mais sait-on jamais, un sursaut pourrait tout changer ? Comme en 88-90 ? Je ne sais pas si l’avenir sera bon. Si cela continue à ce rythme la presse va vers sa mort, ça c’est certain.
C’est un constat très sombre…
Je sens que je ne suis plus en train d’avancer. Je sens qu’il n’y a plus rien. C’est un tout, c’est un environnement, une situation politique… Peut-être qu’il se passe quelque chose. Malheureusement nous n’avons ni syndicat ni conseil d’éthique, c’est la corporation la plus désorganisée qui puisse exister. Vous vous retrouvez toute seule. Nous sommes un groupe de journalistes qui réfléchissions. Mais que peut-on faire ? Rien.
Hassi Messaoud, la violence à l'ombre d'une richesse en trompe l'oeil
"Ces femmes ont été violées, battues, mutilées, certaines enterrées vivantes par une bande de jeunes chauffés à blanc par l'imam de la mosquée de ce quartier qui porte bien son nom El Haïcha (la bête), à Hassi Messaoud." rappelait sans relâche Salima Tlemçani d'un article à l'autre, depuis juiller 2001, sans jamais lâcher les victimes, dont elle suivi les actions en justice, difficiles, en vue d'obtenir réparation.
Une situation de violence récurrente, sociale, économique et sexuelle, dans cet El Dorado de tous les possibles, que la journaliste Ghania Mouffok avait décortiqué quelques années plus tard (juin 2010) pour le Monde diplomatique, en pointant les causes : "Il aura suffi d’un article dans El Watan relatant, en ce printemps 2010, de nouvelles violences contre les femmes dans la ville de Hassi Messaoud pour susciter, en France et dans une moindre mesure à Alger, un vaste corpus de chroniques, d’émissions, de tables rondes et de manifestations de solidarité : Hassi Messaoud serait « la cité du viol »" Déglinguée, la ville est comme à l’abandon, avec ses rues défoncées, ses trottoirs approximatifs et ses façades d’immeubles rafistolées, plaies de ciment sans âge. Omniprésentes, les poubelles nous accompagnent dans tous les coins du quartier, dans les ruelles, et jusqu’au bord du désert où, sur des kilomètres, elles sèchent au soleil.
Autour de la nappe de pétrole, sur 71 000 kilomètres carrés, s’organisent toutes les activités de la région, entre la zone industrielle, les « bases de vie » luxueuses et la commune proprement dite, cuvette cernée par le désert."
Source : information.tv5monde.com
Articles similaires
A Voir aussi
Recette
Agenda
Newsletter
Abonnez vous à la newsletter pour recevoir nos articles en exclusivité. C'est gratuit!

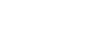




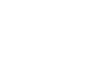

Commentaires