Lévirat: les réalités d’une coutume de mariage décriée en Afrique

Souvent décrié, le lévirat reste pratiqué et débouche dans la plupart des cas sur des mariages forcés ou consentis.
Bobo-Dioulasso. Mayi, 35 ans. « Il y a deux ans après la décès de mon mari j’ai épousé son petit frère. Nous venons d’avoir des jumeaux ». Comme elle, d’autres femmes subissent le lévirat sur le continent. Et dans plusieurs sociétés de la sous-région ouest-africaine, la pratique continue en fonction des ethnies. Dans certaines familles, le décès d’un mari polygame voit même des fils se marier aux coépouses de leurs mamans biologiques. Si cette situation peut choquer, elle est pourtant lue comme une manière noble de prendre soin des veuves. Au Burkina Faso en ethnie mossi, la veuve fait d’ailleurs partie de « l’héritage du défunt ». « Elle revient à l’homme que la famille aura désigné », indique Patrice Bahala, anthropologue burkinabé.
Un moyen pour ne pas perdre la dot versée par le mari à sa belle-famille
La femme est donc considérée comme un bien, justifie-t-on dans certaines sociétés. Elle est comptée parmi les « biens du défunt » pour être partagée. En République centrafricaine, le lévirat est expliqué comme un moyen « de ne pas perdre la dot versée par le mari à sa belle-famille ». Les dénonciations sans cesse constatées n’ont pas encore éteint les flammes du phénomène qui se voit encouragé par des personnes, à priori capables d’y mettre fin. « Des hommes instruits s’adonnent aussi à cette pratique », regrette un membre de WILDAF/Togo (Women in Law and Development in Africa), un réseau de femmes togolaises.
Menaces et spoliations
Dans la plupart des sociétés concernées où la pauvreté reste présente, le lévirat est un moyen de soutenir une famille endeuillée qu’on ne veut pas laisser dans l’indigence. Il est donc demandé à la veuve de se remarier dans la même famille. Elle et ses fils sont censés désormais être pris en charge par son nouveau mari qui est le frère du défunt. « Mes beaux-parents ont estimé que je ne devrais pas rester seule après la mort de mon mari », relate, dépitée, une Togolaise. Trentenaire, elle s’est enfuie de son village pour s’installer à Lomé avec son enfant de 5 ans. Plus de cinq ans après, même si elle s’est remariée, elle dénonce « la honteuse proposition » de son ancienne belle famille.
Les femmes subissent également des menaces. Quand elles refusent, les familles leur mettent la pression. Cela débouche souvent sur des situations inimaginables. Originaire du sud du Bénin, Adakou, 45 ans, qui s’est désormais installée à Djougou au nord du pays, a vécu il y a huit ans ce qu’elle qualifie « d’épisode douloureux ». Contrainte d’épouser l’un des fils de son mari que ce dernier a eu avec une autre épouse, cette mère de deux garçons a refusé. « Je ne pouvais pas », confie-t-elle. Mais, poursuit-elle, « j’ai été menacé, ma belle-famille m’a même envoûtée. J’étais tombée malade et mes enfants m’ont été retirées. Mes parents ont dû faire des cérémonies pour me sauver. »
Derrière l’idée de «prendre soin de l’épouse de son frère »
Pour Kouadio Houoyi sociologue ivoirien, auteur d’une étude sur la question, il existe une autre face négative de la pratique. Selon l’universitaire, le prétendant de la femme endeuillée est souvent intéressé par l’héritage de son frère défunt. Derrière l’idée de « prendre soin de l’épouse de son frère », l’homme en profite pour contrôler l’héritage du défunt. Conséquence, les veuves et les orphelins vivent souvent de conditions de vie difficiles. Au Ghana où la pratique existe, certaines veuves se sont retrouvées laissées à elle-même après avoir épousé les petits frères de leurs maris. « Les terrains et les deux taxis de mon défunt mari ont été vendus. Mes enfants et moi n’avons rien eu », témoigne l’une d’entre elles. Kouadio Houoyi souligne cependant que toutes les femmes ne sont pas contre la pratique. « Il y a des femmes qui acceptent sans pression le lévirat ».
Dénonciation et sensibilisation
Pour combattre la pratique, les associations de défense des droits des femmes organisent des campagnes de sensibilisation. Soutenues par des campagnes médiatiques, ces séances de sensibilisation sont intensifiées à l’endroit des populations analphabètes. Au Sénégal, l’Association pour la promotion de la femme sénégalaise (Aprofes) sensibilise régulièrement les veuves sur les voies dont elles disposent pour « se libérer ». « On leur explique qu’on ne peut pas les forcer à se marier et qu’elles peuvent porter leur affaire en justice », explique un membre de l’Aprofes. Il faut dire que dans les pays de la sous-région, les pressions légales existent et les femmes ont le droit de dire non au mariage forcé. Cependant on note une absence de répression du lévirat dans les législations nationales.
Sur un autre plan, des associations féministes ont été créées. Elles axent leur lutte sur une violence des droits des femmes et évoquent également le risque pour les victimes de contracter des maladies sexuellement transmissibles comme le VIH/SIDA. Mais « le combat contre le lévirat » se mène aussi sur le terrain économique. Des ONG s’impliquent dans la lutte pour l’élargissement de la couverture sociale dans les États. L’absence d’une inclusion financière dans les pays favorise le phénomène, reconnaît une élue de la sous-région. Propos confirmé par la sociologue Isabelle Gillette-Faye. Selon elle, le lévirat persiste dans les pays où on note une absence de système de sécurité sociale « au sens large du terme ». Lorsque la veuve ne peut plus gagner sa vie après le décès de son mari, elle accepte malgré elle de rester dans le foyer, de peur « de mourir de faim elle et ses enfants ».
Mais dans les villes, la pratique est moins présente, certaines femmes ne cèdent pas non plus à la peur. A Lomé, une commerçante de 47 ans confie : « Une semaine après le décès de mon mari, mon beau-père m’a informé que je devrais aller vivre avec le petit frère de mon mari. J’étais abattue, quand deux jours après l’enterrement, le frère de mon mari exigeait de coucher avec moi. Nous avons déménagé mes enfants et moi pour louer dans un autre quartier. Pour moi c’était inacceptable. Aujourd’hui je suis libre. »
Source : afrotribune.com
Articles similaires
A Voir aussi
Recette
Newsletter
Abonnez vous à la newsletter pour recevoir nos articles en exclusivité. C'est gratuit!

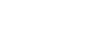

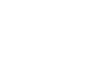

Commentaires