Touhfat Mouhtare : « Les femmes sont instrumentalisées, mais n’en ont pas forcément conscience »

Avec son nouveau roman, « Le Feu du milieu », mettant en scène deux héroïnes aux statuts sociaux bien différents, la romancière comorienne propose un conte allégorique au carrefour des croyances ancestrales et de l’islam.
On avait lu en Vert cru de Touhfat Mouhtare, un excellent roman et une promesse : celle d’une autrice à suivre. Le Feu du milieu confirme tout le bien que l’on pensait de l’écrivaine comorienne née en 1986 à Moroni.
Gaillard est une jeune servante dans la cité d’Itsandra, aux Comores. Un jour où elle va chercher du bois, elle tombe sur Halima, jeune fille de noble qui fuit un mariage arrangé. Deux personnes, deux statuts sociaux, mais un destin commun, même lorsque, par la suite, elles sont séparées pendant dix ans. Entre elles, il y a un dé aux pouvoirs surnaturels. Plus qu’un objet, c’est un lien qui leur permet de rester connectées par-delà l’espace-temps et de défier la matière.
Comme le dé, la narration du Feu du milieu transcende les genres, entre le conte allégorique, le roman picaresque et le réalisme magique. Il convoque les sens dans un feu d’artifice de saveurs, de couleurs, d’odeurs, de goûts et nous ouvre à d’autres dimensions de l’existence. Le trait d’union entre ces dimensions : l’amour. Les fabuleux voyages de Gaillard, de son maître, le Fundi, et d’Halima sont une odyssée des temps modernes nourrie par une imagination et une sensibilité débordantes. Une quête de sens, aussi, au carrefour des croyances et de la connaissance.
Jeune Afrique : Le Feu du milieu est un roman qui se lit et qui se ressent. Êtes-vous une écrivaine des sens ?
Touhfat Mouhtare : Je ressens intensément les choses, et j’ai mis du temps à l’assumer. Je n’ai pas de recul sur ce que j’écris, sur ce que je ressens. Je vis les choses de manière très intense. Le Feu du milieu est le livre dont je suis le plus fière, parce que je me suis posée devant mon cahier et mon ordinateur, et que j’ai décidé de laisser parler ce que je portais. Je ne m’attendais même pas à ce qu’il soit publié. Je me suis juste dit que je voulais laisser parler cette histoire, ces personnages qui me hantaient. Je me suis permis de ressentir. C’était magique, c’est un livre qui m’a fait beaucoup de bien. Finalement, j’ai trouvé une éditrice sur la même longueur d’onde que moi, et je rencontre un public qui ressent, lui aussi, les choses.
Que ce soit Gaillard, esclave, ou Halima, princesse, les femmes sont les objets du désir masculin. Quelle que soit sa condition sociale, on ne peut pas échapper à sa condition de femme ?
Je n’ai pas voulu écrire intentionnellement un roman sur la condition féminine, mais j’ai voulu adopter le point de vue de femmes, fidèlement retranscrire la manière dont elles vivaient les circonstances, leur vie. En effet, on se rend compte en lisant à travers leur regard qu’elles sont instrumentalisées, mais n’en ont elles-mêmes pas forcément conscience ». Elles découvrent naïvement les choses.
DEUX PERSONNALITÉS COHABITAIENT EN MOI : CELLE QUI A ASSERVI ET CELLE QUI A ÉTÉ ASSERVIE
Cette idée que la femme a pu être un objet ou un instrument pour l’honneur du père et de la mère est un sujet de conversation que j’avais abordé avec mes parents. Ils me racontaient des anecdotes qui étaient pour eux des événements normaux, à propos de mariages forcés, arrangés, etc. Cependant, ils n’utilisaient jamais les termes « forcé » ou « arrangé » : c’était leur réalité. Je me suis rendu compte que je m’offusquais, ancrée dans mon époque, d’un événement datant d’une autre époque, d’une autre vision des choses, et cela m’a posé question. Ces femmes se sentaient-elles considérées comme des objets ? J’ai voulu coller au maximum à leur regard, sans juger. LIRE PLUS SUR JEUNEAFRIQUE
Articles similaires
A Voir aussi
Recette
Newsletter
Abonnez vous à la newsletter pour recevoir nos articles en exclusivité. C'est gratuit!

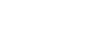

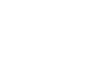

Commentaires