Bernardine Evaristo : « Je ne veux pas être esclave de l’Histoire »

Alors que deux de ses ouvrages paraissent en français, rencontre avec l’écrivaine militante d’origine nigériane, lauréate du prestigieux Booker Prize en 2019 et présidente de la Royal Society of Literature.
Et si les Européens avaient été réduits en esclavage par les Africains ? C’est en déployant ce récit inversé de l’Histoire que le dernier roman de Bernardine Evaristo traduit en français, Des racines blondes, questionne les ressorts du racisme jusqu’à nos jours. L’autrice de 63 ans, qui est aussi dramaturge et professeure d’université, préside, depuis l’année dernière, la prestigieuse Royal Society of Literature. Avec son récit choral, Fille, femme, autre, elle a été, en 2019, la première femme noire couronnée du renommé Booker Prize. Rencontre.
Dans Des racines blondes, vous créez un monde où les Africains tiennent les Européens en esclavage. Comment est-il né ?
Bernardine Evaristo : Je voulais écrire sur la traite transatlantique, c’est une page importante de l’histoire du monde. Et en tant que romancière, je cherchais une manière d’emporter les lecteurs dans une direction inattendue. Personne n’avait encore proposé ce prisme d’un monde où les esclaves seraient les Européens. Il m’a permis d’examiner l’ampleur et l’absurdité des ressorts de l’esclavage, tout autant que le racisme aujourd’hui, et ses origines.
Dans votre essai, Manifesto – N’abandonnez jamais, où vous retracez votre parcours, vous confiez que « les idées dangereuses sont les seules qui [vous] intéressent ». Quelle était la part de mise en danger dans Des racines blondes ?
C’était osé parce que la traite transatlantique est une thématique extrêmement sensible, même actuellement. C’est une histoire qui sous-tend toute celle des États-Unis, au-delà de celle des Africains-Américains. Au Royaume-Uni, cela peut paraître un peu plus lointain, parce que l’esclavage s’est matérialisé surtout dans les Caraïbes. nverser l’histoire, c’est prendre le risque de choquer des gens, que certains imaginent que je ne prends pas le sujet au sérieux. Ce n’est évidemment pas le cas. Dans mon écriture, je combine le tragique et le comique, dans ce récit comme dans tous mes livres.
C’est un récit documenté, comme The Emperor’s Babe ou Soul Tourists. Comment entremêlez-vous fiction et faits historiques ?
Je suis très irrévérencieuse. Parfois je m’en tiens aux faits historiques, parfois je joue avec eux. Ce sont des allers-retours entre l’écriture et les recherches. En tant que créatrice, je ne veux pas être l’esclave de l’Histoire. Pour Des racines blondes, j’ai lu beaucoup, notamment Roots, de Alex Haley. J’ai aussi visité le musée de l’esclavage de Liverpool.
Dans Manifesto, vous questionnez votre rapport à l’Afrique depuis l’adolescence, moment où vous prenez conscience que l’idée que vous vous faisiez du continent « était un concept n’existant que dans l’imagination des Européens ». Quel était cet imaginaire ?
J’ai grandi avec un père nigérian qui ne parlait jamais du Nigeria. Je ne savais rien de ce pan de mon histoire. Dès lors, quand j’étais enfant, l’« Afrique », « être africaine », était quelque chose de négatif. J’avais intériorisé le racisme de la société britannique.
À 19 ans, j’ai commencé à m’intéresser à mon histoire africaine et à l’histoire des Noirs. Alors l’Afrique est devenue mythologique. J’ai appris que des membres de notre famille vivaient toujours au Nigeria et, après avoir voyagé au Kenya, en Égypte et à Madagascar, j’y suis allée. Je me suis demandé si ce pays pourrait être ma patrie. Je me suis rendu compte que non. LIRE PLUS SUR JEUNEAFRIQUE
Articles similaires
A Voir aussi
Recette
Newsletter
Abonnez vous à la newsletter pour recevoir nos articles en exclusivité. C'est gratuit!

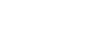

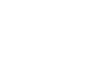

Commentaires