Jean-Paul Dossou : « Payer avant d`accoucher est la première violence faite aux femmes »

Depuis le 21 octobre à Dakar, chercheurs et professionnels de la santé maternelle échangent sur les violences subies par les femmes lors de l’accouchement en milieu sanitaire.
Négligée pendant des années, l’expérience vécue par les femmes dans les établissements de santé lors de leur accouchement devient une préoccupation en Afrique de l’Ouest. En 1994, une première étude montre qu’elles sont souvent, et dans de nombreux pays, victimes de différentes formes de violences, au point que les centres où les femmes devraient se sentir écoutées et en sécurité sont en fait les lieux de traumatismes parfois sévères.
Médecin béninois spécialisé en santé publique et chercheur affilié au Centre de recherche en reproduction humaine et en démographie (Cerrhud) de Cotonou, Jean-Paul Dossou donne les clés de compréhension en s’appuyant sur ses observations dans une quinzaine de centres à travers le Bénin.
Quelles violences peuvent vivre les femmes dans les établissements de santé ?
D’abord, il faut s’entendre sur le vocabulaire. La violence obstétricale et la maltraitance ont des enjeux légaux et pénaux. L’irrespect et les abus sont plutôt de l’ordre du comportement. D’ailleurs, le concept de « soins respectueux » est de plus en plus utilisé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour sa connotation plus positive.
L’OMS a identifié sept catégories de maltraitances que peuvent expérimenter les femmes dans les formations de soins : la violence physique (recours à la force), sexuelle ou verbale (menaces, railleries), la discrimination et la stigmatisation (fondées sur le genre, l’ethnie, l’âge, etc.), le non-respect des standards professionnels (négligence, violation de la confidentialité), la mauvaise relation soignants/soignés, et enfin les contraintes liées au système de santé, comme le manque de matériel fondamental qui contribue à déshumaniser le vécu des femmes dans cet environnement.
Comment expliquer ces violences au sein même de centres où les futures mères vont justement chercher aide et réconfort ?
Le Cerrhud travaille sur cette problématique depuis 1995 avec d’autres institutions comme la London School of Hygiene and Tropical Medicine et l’Institut de médecine tropicale d’Anvers. Les données récoltées permettent d’établir une théorie plausible, qui invoque la notion de « capital », tel que le définit le sociologue français Pierre Bourdieu.
Le mécanisme primordial qui peut expliquer les violences subies, c’est la différence systématique de « capital culturel » et de « capital symbolique » entre les soignants et les soignés. Et plus ce différentiel est grand, plus il y a de risque que la patiente subisse des violences. Qu’elle soit riche ou pauvre, très entourée ou non.
Pouvez-vous préciser ?
Celui qui détient la connaissance sur l’accouchement, c’est le soignant. Que ce capital soit fondé sur des connaissances réelles ou des données qui ne sont pas internationalement reconnues, seule sa voix porte. Il dispose donc d’un capital culturel largement supérieur.
Ensuite, nos sociétés accordent une valeur symbolique très forte aux prestataires. Le médecin est considéré comme un demi-dieu. En épouser un ou une est perçu comme un élément de prestige social. La femme qui arrive à l’hôpital, au contraire, confesse d’emblée sa vulnérabilité. Dans un pays comme le Bénin, où il y a 397 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes selon les chiffres de 2017, le risque inhérent à la grossesse et à l’accouchement imprègne profondément les mentalités.
Il est donc très courant d’entendre dire d’une femme pendant la période d’accouchement qu’elle a un pied dans la tombe. Il faut bien se rendre compte qu’il est près de cent cinquante fois plus probable pour une femme à partir de l’âge de 15 ans de mourir à cause d’une grossesse ou lors de l’accouchement au Bénin qu’en France. La femme s’abandonne donc au soignant. Du point de vue culturel et symbolique, le rapport entre les soignants et les soignées est très déséquilibré. C’est dans ce déséquilibre que s’installe la violence.
Les femmes sont-elles toujours passives face à ces violences ?
Non, pas toutes. Au Bénin, en milieu urbain, la libéralisation de l’information médicale a construit des « patientes expertes ». Mais encore faut-il que la voix de la femme soit écoutée. Ensuite, les femmes ne sont pas des murs dans lesquels on tape sans qu’il ne réagisse. La stratégie que l’on a pu observer consiste à minimiser le plus possible la violence tout en optimisant le résultat des soins. Elles réagissent simplement à des degrés divers selon leurs ressources. Les plus touchées par les violences sont les « naïves », qui ignorent les règles. Elles vont être des cibles « faciles ».
C’est aussi compliqué pour celles qui, certes connaissent les règles, mais ne peuvent les respecter. Une femme qui sait qu’elle doit payer pour pouvoir être bien suivie lors de son accouchement, sans avoir l’argent nécessaire, va essayer de négocier. Mais elle s’expose tout de même aux railleries, à la honte. D’autres encore connaissent les règles et savent qu’elles les ont respectées, ce qui leur permet d’être plus exigeantes en termes de qualité des soins.
Depuis la publication des premières études, des mesures ont-elles été prises ?
Les travaux ne nous permettent pas de quantifier la maltraitance, mais nous savons qu’elle perdure. En 2017, le gouvernement béninois a commencé à mettre en place une série d’actions pour moraliser les pratiques des soins. Il y a des efforts explicites pour fermer des formations sanitaires considérées comme illégales, introduire des sanctions. Une ligne verte a été créée pour que les comportements abusifs puissent être dénoncés. Mais nous avons besoin de plus de recul pour mesurer les effets de ces stratégies.
Quels sont les obstacles majeurs au changement ?
Le plus net au Bénin, c’est l’absence de redevabilité. Les soignants n’ont pas de compte à rendre. Cette réalité s’appuie sur la perception du médecin tout-puissant, le secret médical, la technicité du jargon médical qui le rend inaccessible à tout un chacun. Il faudrait une justice spécialisée sur le système de santé et le parcours médical du patient devrait être documenté pour donner de la transparence. L’autre obstacle majeur réside dans l’absence d’une politique de financement de la santé qui prenne le sujet dans sa globalité et donne place à l’usager des services de santé.
La violence médicale se limite-t-elle à la femme et l’accouchement ?
Homme ou femme, le capital symbolique du malade est faible. Il est plus souvent déterminé par la nature de la maladie que par le sexe. Mais je n’exclus pas que ce qu’il se passe dans l’environnement de soins soit aussi accentué par l’auto-vulnérabilisation des femmes dans la société. Je trouve, par exemple, qu’exiger de la femme qu’elle paie avant d’accoucher, qu’elle en sorte vivante ou non, elle et son enfant, est une violence de genre inadmissible. Cette exigence n’est pas spécifique à la femme mais là, en l’occurrence, c’est elle qui en subit les conséquences. Et peut le payer de sa vie.
Faudrait-il alors que les soins de maternité deviennent gratuits ?
Depuis 2009, la césarienne est gratuite au Bénin. Mais cela n’a pas fait disparaître les violences. D’autres ont surgi. Quand c’est gratuit pour la femme qui va accoucher, c’est que la société paie pour elle. On va donc penser qu’elle est bien chanceuse et qu’elle n’a pas à revendiquer quoi que ce soit. Son capital symbolique s’en trouve encore plus réduit. En plus, un soignant aura moins de scrupule à lui extorquer de l’argent…
Que faire alors ?
Il faut mieux étudier la question en se décentrant de la personne soignée, considérer les accompagnants, et ne pas oublier que les auteurs de violences ne sont pas seulement le médecin ou la sage-femme. Cuisinières ou gardiens peuvent aussi exercer des violences, verbales par exemple. Ensuite, il faut réduire le différentiel entre patiente et soignant en valorisant la femme qui donne la vie. Les cérémonies officielles doivent leur rendre hommage.
Enfin, les soignants doivent eux-mêmes être soignés. Ils sont constamment exposés à la mort et on sait peu de cas de leur état psychologique. Les chercheurs doivent se demander comment la banalisation de la mort, indispensable à la survie psychologique du soignant, dans un environnement où la mortalité est très élevée, peut conduire à la violence dans les soins.
Source: lemonde.fr
Articles similaires
A Voir aussi
Recette
Agenda
Aucun évènement
Newsletter
Abonnez vous à la newsletter pour recevoir nos articles en exclusivité. C'est gratuit!

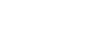
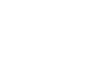

Commentaires